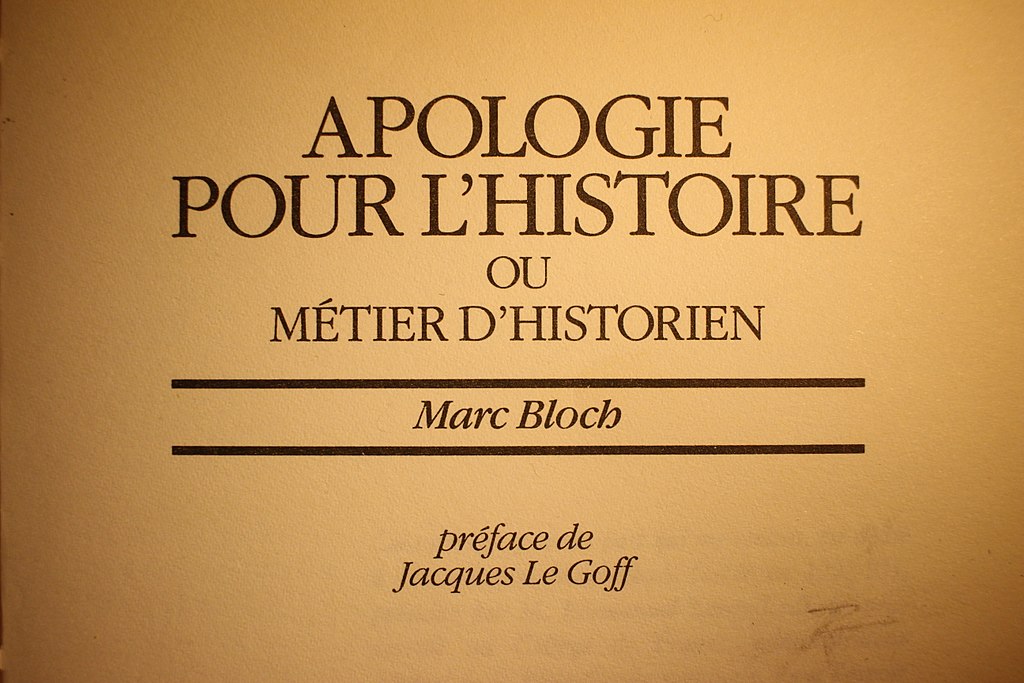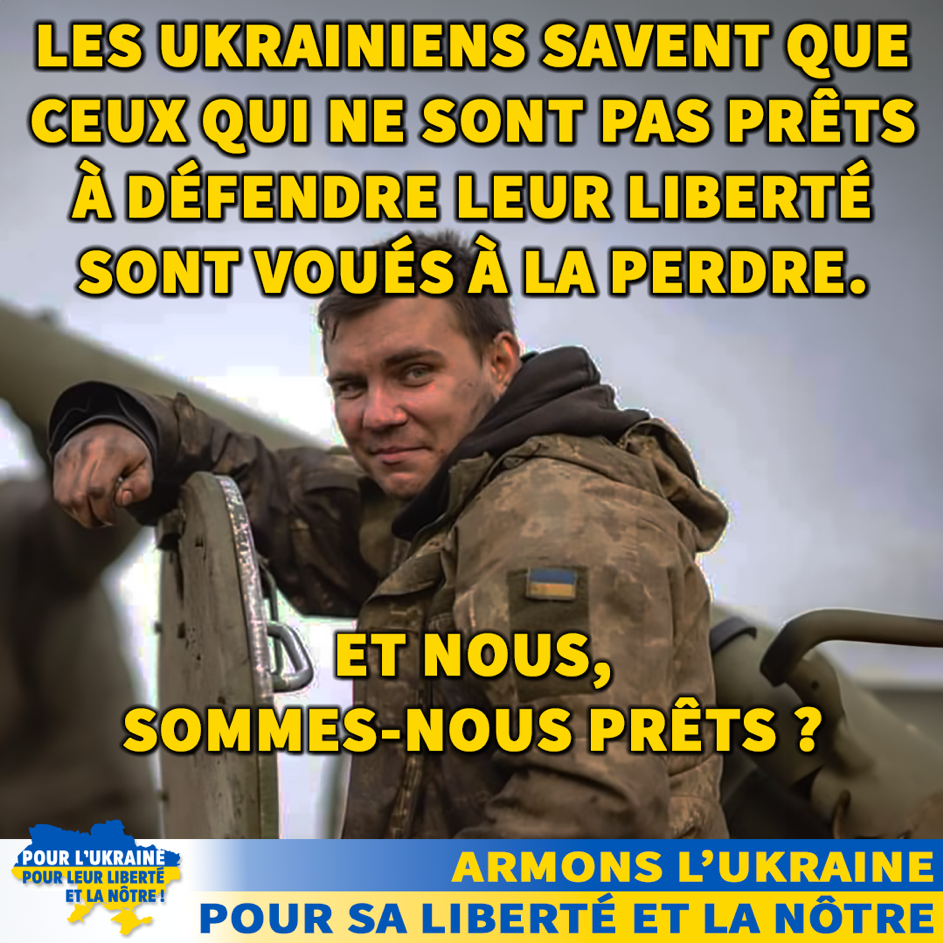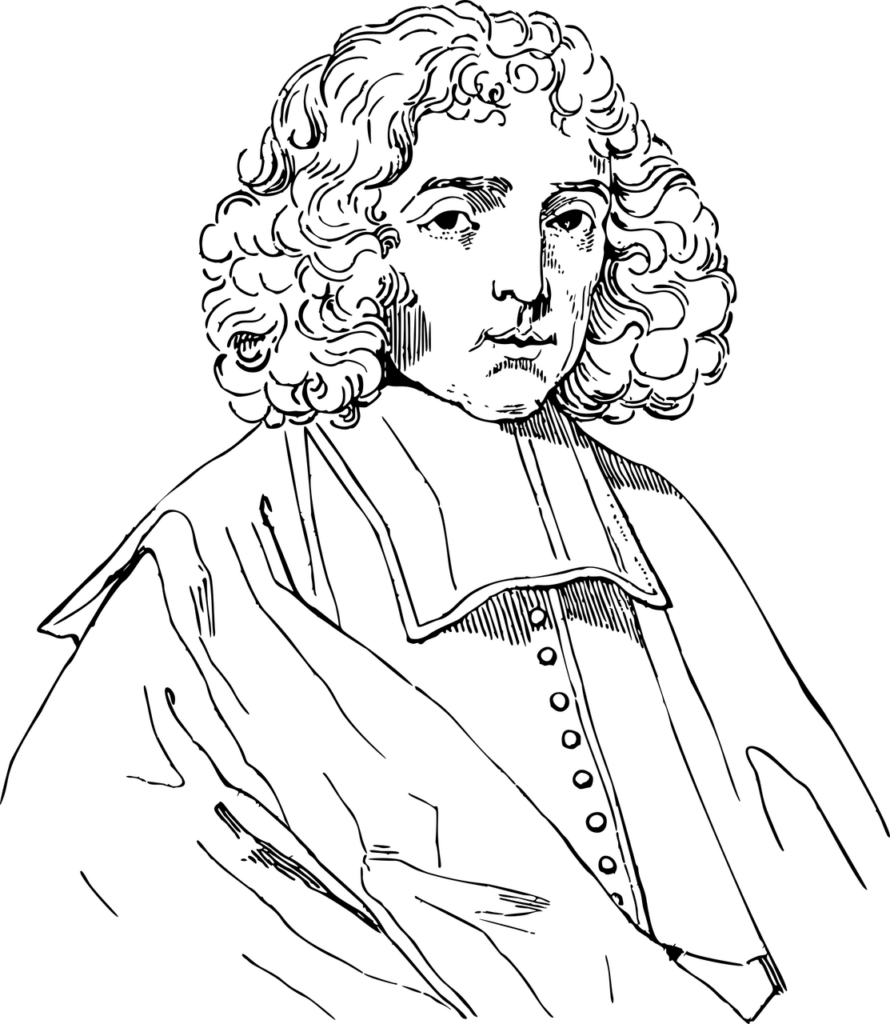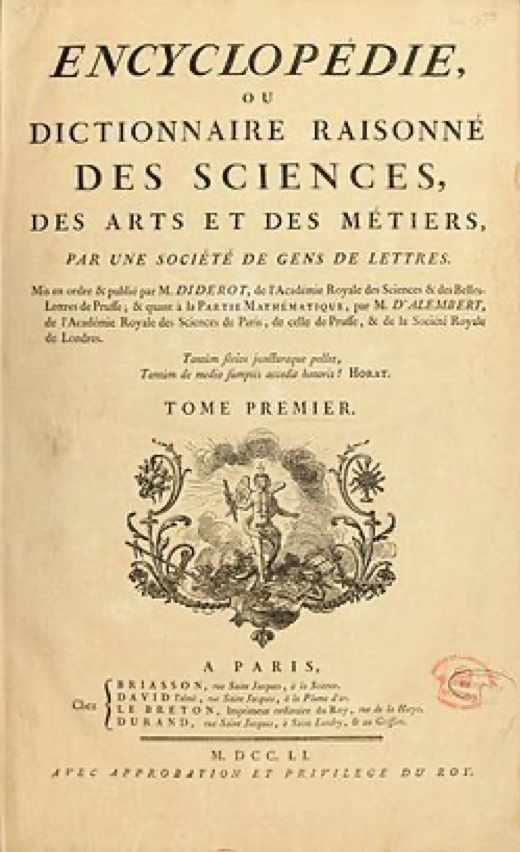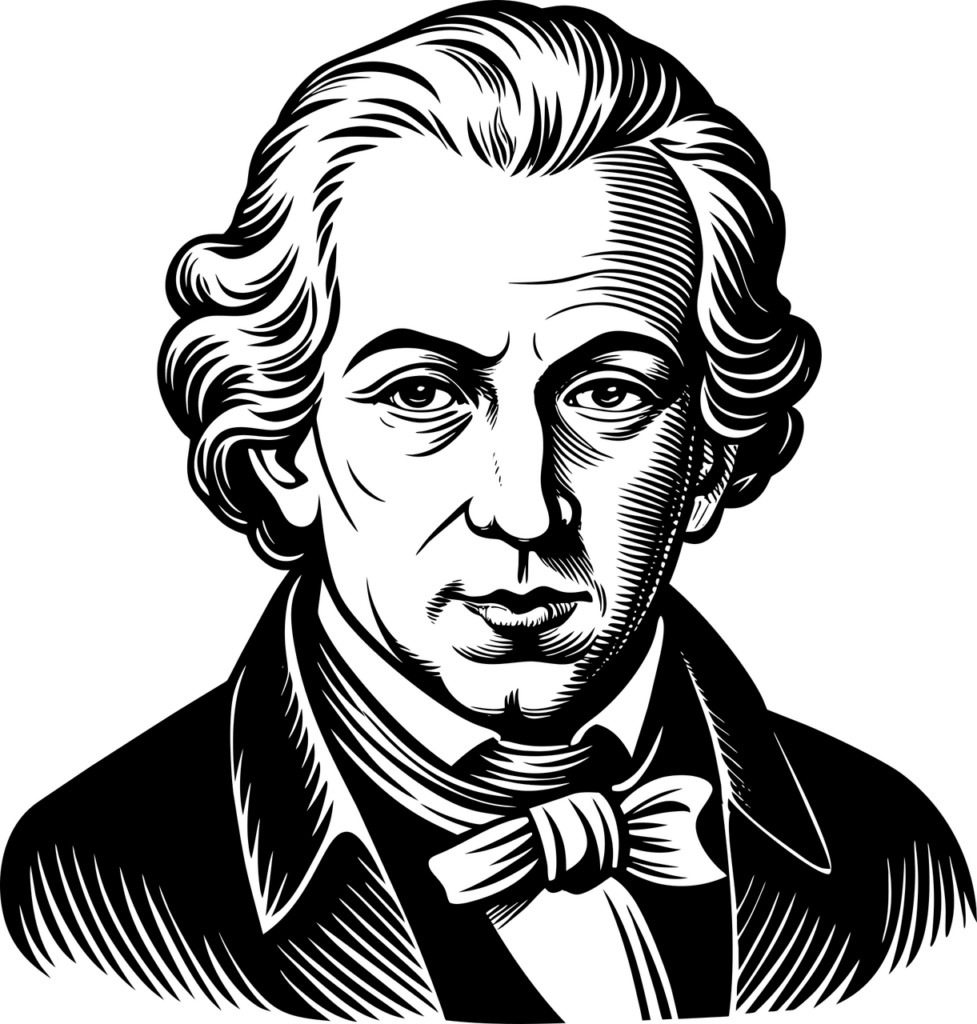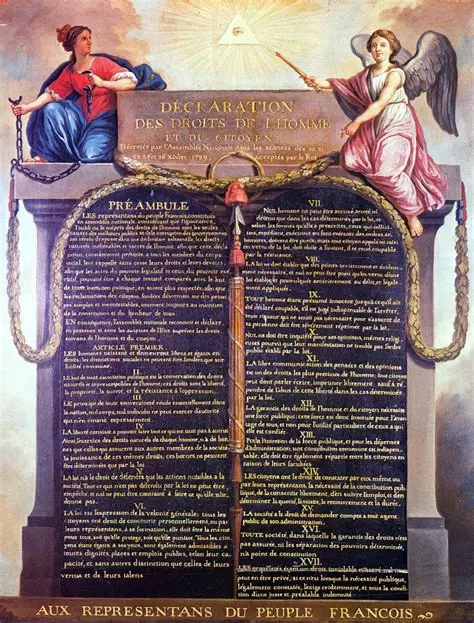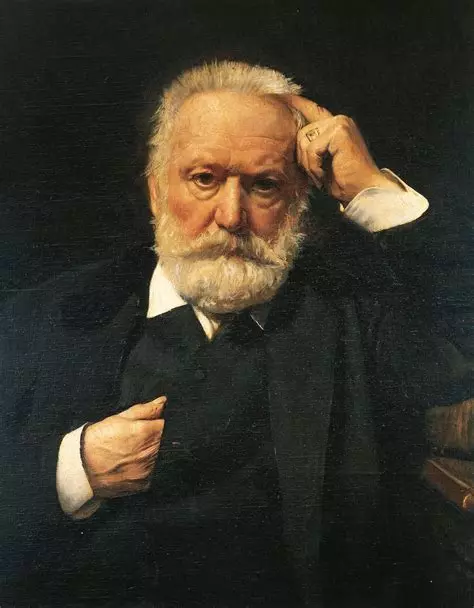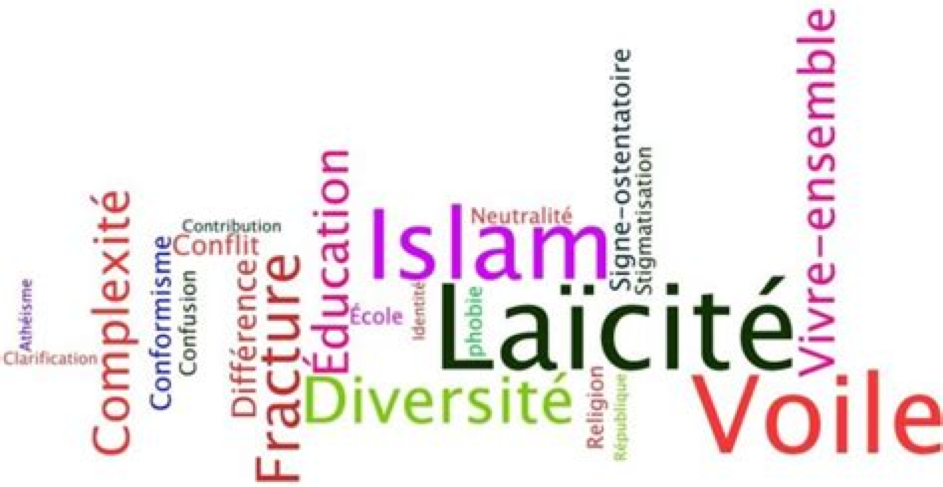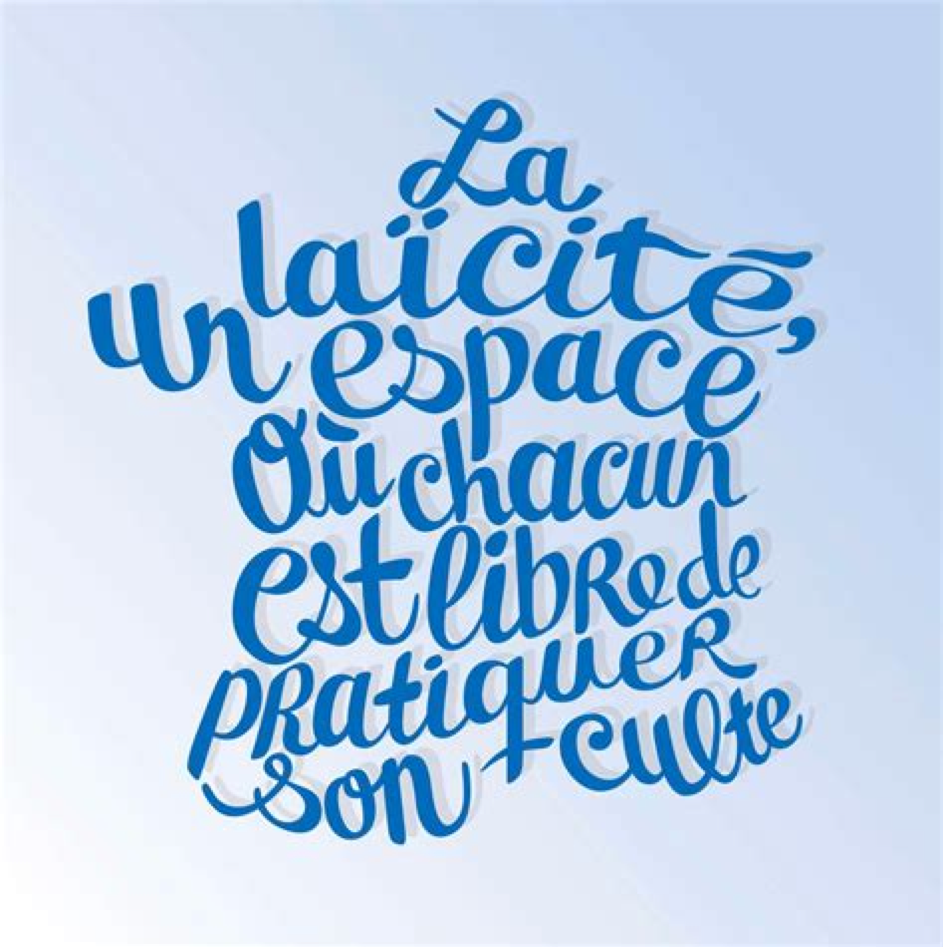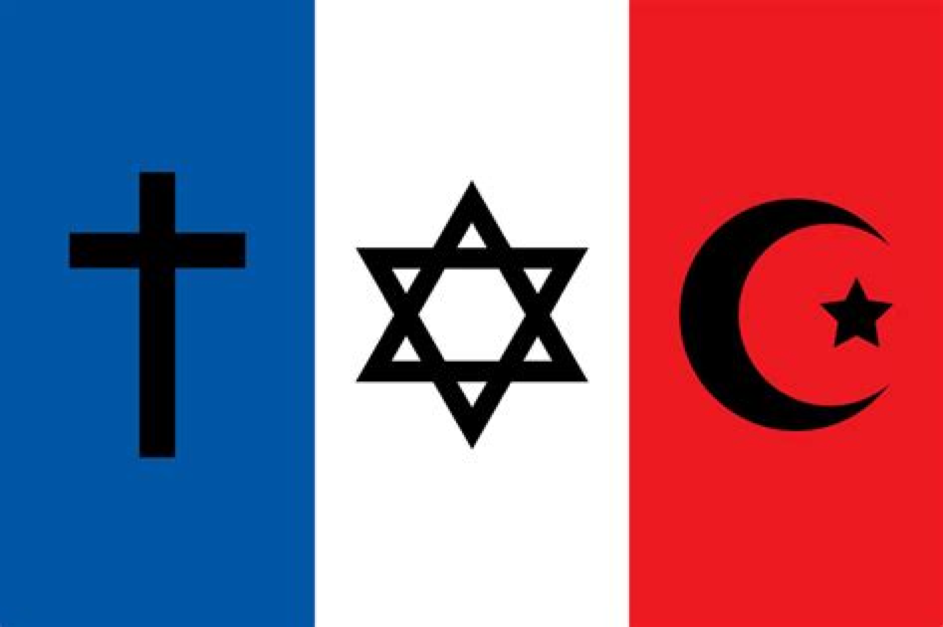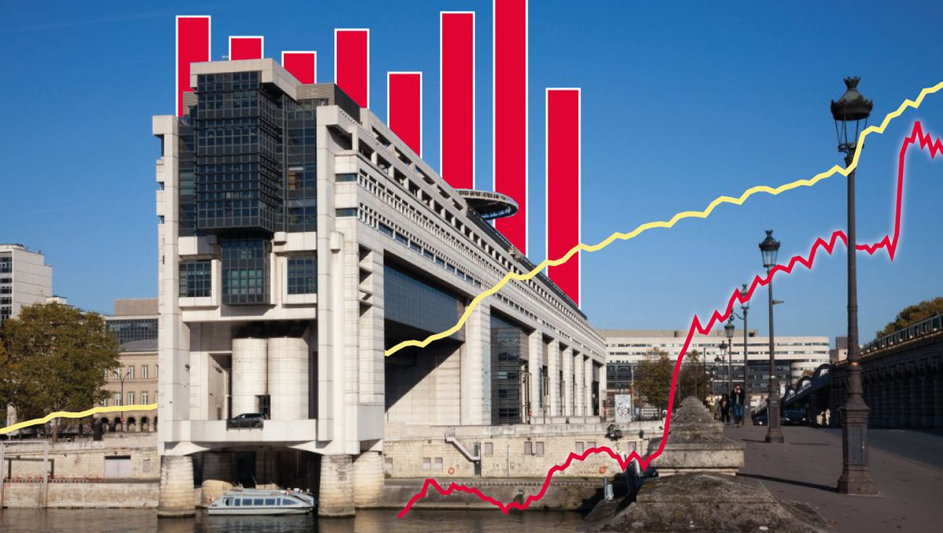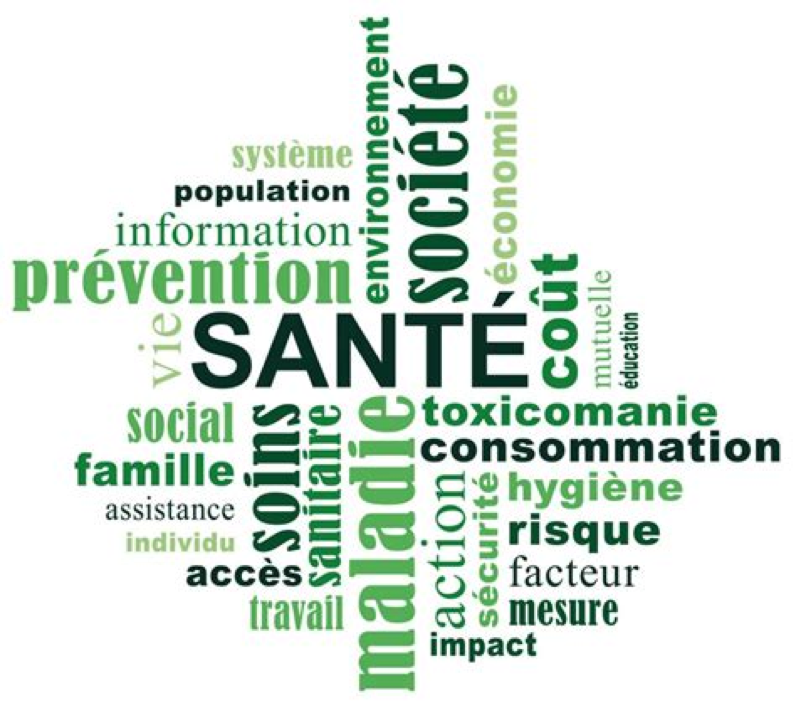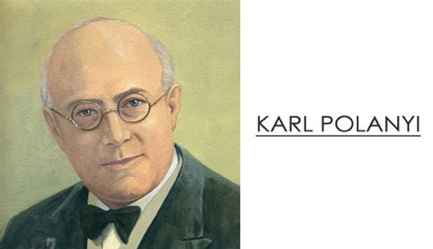Avec la réélection de Donald Trump à la présidence des États Unis nous assistons à l’augmentation de l’influence d’un courant idéologique faisant la liaison entre les utopies libertariennes et les valeurs conservatrices. Un article du journal « Le Monde » signé par Valentine Faure en fait une analyse détaillée. Je vous en livre l’essentiel.
Des pouvoirs sans précédent

En 2020 Elon Musk était démocrate mais en 2024 c’est avec zèle qu’il s’est employé à la réélection de Trump. Il a investi plus de cent millions de dollars sur quelques mois dans la campagne et mis à disposition du candidat républicain son réseau d’information. Il a fait un bon investissement puisqu’une semaine après l’élection sa fortune personnelle avait déjà augmenté de 70 milliards de dollars.

La mue de l’homme le plus riche du monde n’est pas la seule. D’anciens donateurs du Parti Démocrate ont suivi la même trajectoire que Musk, notamment Peter Thiel qui a cofondé avec lui Pay Pal et qui est devenu très riche avec son investissement dans Facebook. Une partie des dirigeants de la Silicon Valley ont basculé vers le soutien au Parti Républicain. Sur les 70 milliardaires que compte la Silicon Valley, ils sont une vingtaine à soutenir le 47ème président des États Unis. « Mais ces vingt personnes ont un accès direct à l’espace public médiatique mondial qu’ils ont eux-mêmes composé. La concentration des pouvoirs qu’ils ont entre leurs mains, l’accès aux technologies et leur capacité à mettre en pratique ce en quoi ils croient est sans précédent » dit Olivier Alexandre, sociologue, chercheur au CNRS.
Un ennemi commun
Selon un rapport de l’ONG Public Citizen l’industrie des cryptomonnaies représente près de la moitié de l’argent versé par les entreprises aux comités d’action politique en 2024. Le Parti Républicain soutenu par ces donateurs reviendra sur les mesures qui entravent le développement des technologies nouvelles.
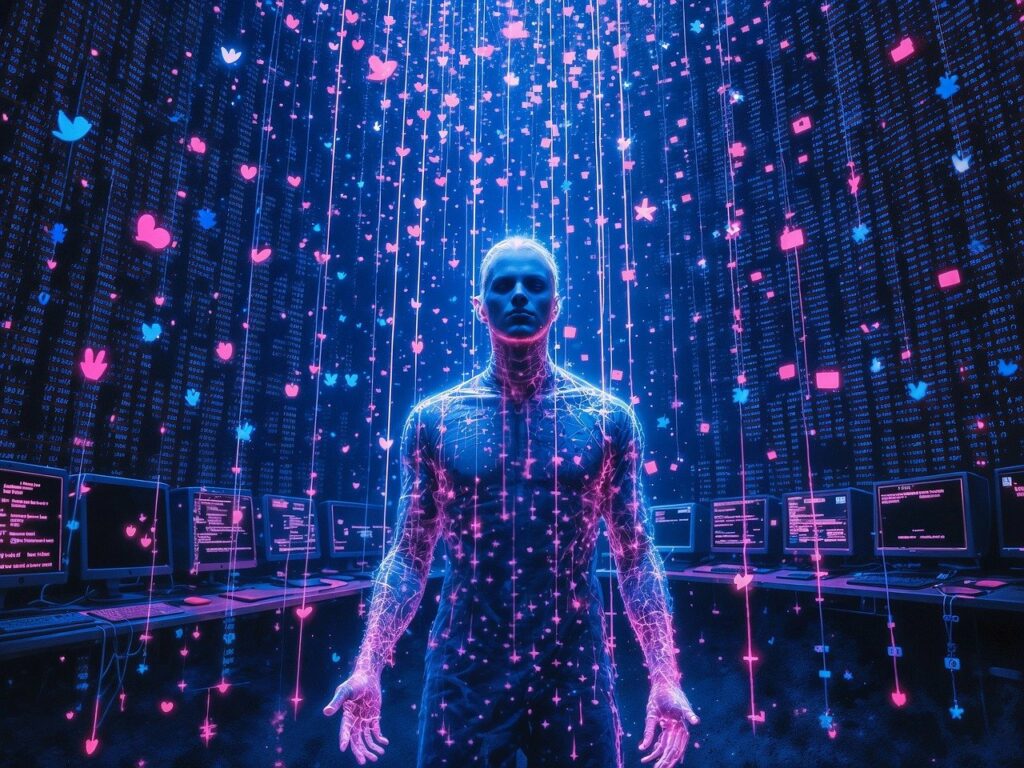
La bureaucratie est l’ennemi général dans la Silicon Valley. L’État n’est pas efficace, il impose un tas de réglementations idiotes qui font perdre du temps et des talents. Il faut gérer l’État comme une entreprise. Le progrès technologique doit être poursuivi sans relâche, sans se préoccuper des coûts potentiels ou des dangers pour la société. La bureaucratie doit céder la place à un « CAO(PDG) national » dit Curtis Yarvin, qui pense que les différences génétiques font que certains groupes sont « plus aptes à la maîtrise », tandis que d’autres sont « plus aptes à l’esclavage ». Ce penseur de la droite radicale a contribué à populariser un tournant de la droite américaine contre la démocratie et les valeurs conservatrices traditionnelles, tout en aidant à normaliser des vues racialistes autrefois absentes du conservatisme américain. C’est un exemple des nouvelles tendances importantes dans la pensée et l’activisme de l’extrême droite radicale.

La droite tech s’estime muselée par la gauche libérale. Elle considère que l’argent ne doit pas être dépensé pour réduire les inégalités, mais pour financer les progrès technologiques. Elle rejette la discrimination positive et la « diversité ». Un commentateur d’extrême droite, Richard Hanania, estime que : « bien qu’il y ait des différences avec le conservatisme américain, il n’y a aucune raison pour que les deux parties (conservateurs et droite tech) ne puissent travailler ensemble dans un avenir prévisible. La forme de notre politique et de notre culture dans les décennies à venir dépendra de la mesure dans laquelle ils le feront ».
Trouver un terrain d’entente
Le nouveau vice-président des États-Unis, J.D. Vance, ancien sénateur anti élite passé par l’université de Yale, est le visage de cette « nouvelle droite » qui tente de donner une orientation encore plus radicale (en matière de nationalisme, de politique anti-immigration, d’opposition à l’interventionnisme américain) à la révolution idéologique commencée par Trump. Cette ligne s’incarne dans le « Projet 2025 » rédigé par la Fondation Héritage, très puissant cercle de réflexion de la droite conservatrice.

The Héritage fondation, leadership for América
Dans un débat sur « la tech et la république américaine », Kevin Roberts, le président de Héritage s’interrogeait : « Comment le conservatisme et la technologie peuvent-ils trouver un terrain d’entente pour stimuler l’innovation tout en protégeant la liberté d’expression, les libertés individuelles et l’autogouvernance ? ». Il y précisait que « les conservateurs et les (gens de la tech) ne doivent pas seulement collaborer, ils sont en réalité des esprits frères » et l’IA représente « un des plus grands espoirs pour protéger la souveraineté de l’être humain ».
La droite tech a son « CAO national » !
Après l’élection du 5 novembre, les félicitations de l’élite technologique à Trump sont arrivées promptement. Elon Musk est remercié par une nomination à la tête de l’efficacité gouvernementale où il prévoit une coupe de deux billions de dollars. L’Amérique a le « CAO national » dont la droite tech rêvait.
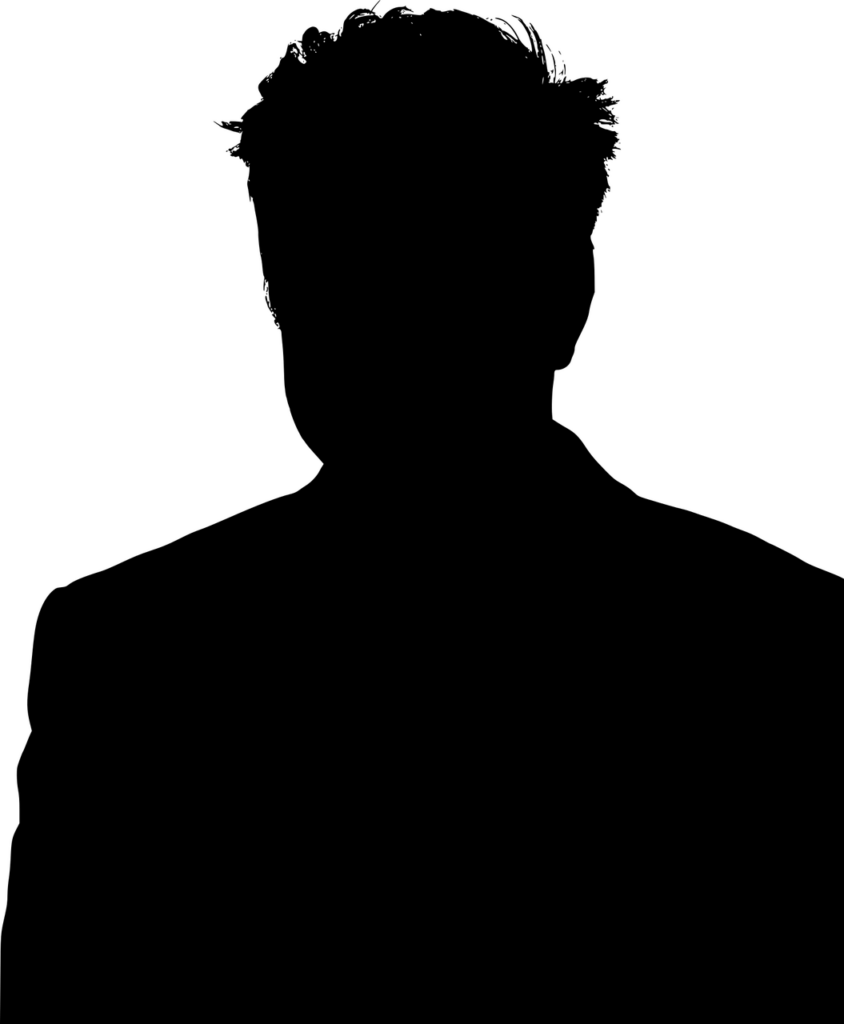
Amazon, propriété de Jeff Bezos, et Meta propriété de Mark Zukerberg, ont annoncé donner chacune un million de dollars au fonds d’investiture de Donald Trump. Ces deux patrons de la tech étaient historiquement considérés comme des opposants au futur président. Ces donations témoignent de la volonté qu’ils ont de se rapprocher du président élu.
Comment résoudre la contradiction ?
Comment résoudre la contradiction d’une alliance entre le parti de la tradition qui tient le langage de la nostalgie d’une Amérique perdue (Make América Great Again) et qui défend un retour à une économie pré-New deal, protectionniste et isolationniste, avec une industrie aux intérêts supranationaux qui promet au monde les bouleversements les plus violents et les plus incertains ?

Restons attentif à ce qui risque de se passer aux USA et dans le monde après le mois de janvier 2025 !