La dette publique est au centre du débat économique et politique français. C’est une question qui ne date pas d’hier. Le montant de la dette grimpe en continu pratiquement depuis plusieurs décennies. Certains pensent que c’est un phénomène non maîtrisé qui va nous mener à la catastrophe. Par conséquent il faut faire des économies importantes sinon nous risquons de nous trouver livrés à la troïka qui a mis à genoux la Grèce. Tout est fait et dit pour pousser les Français à accepter une politique d’austérité d’ampleur. Mais qu’en est-il exactement ? Ne peut-on essayer de voir les choses le plus objectivement possible en dehors de tout préjugé et de toute polémique partisane ?

Faut-il avoir peur de la dette ?
C’est le titre d’un dossier consacré au débat budgétaire par le magazine « Alternatives économiques » daté de novembre 2025. Il nous aide à mieux comprendre ce qui se joue à l’Assemblée nationale. A la fin du premier semestre 2025, le niveau de la dette est proche d’un des plus hauts observés en temps de paix. Il est de 3416,3 milliards d’euros soit 115,6% du PIB (Produit intérieur brut, richesse annuelle créée dans le pays). Cela signifie que pendant des années la France à dépensé plus que ce qu’elle engrangeait en recettes.
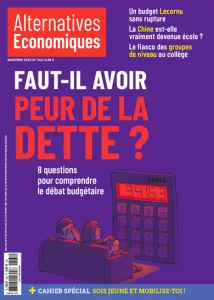
Les causes principales de l’augmentation de la dette
- Les deux chocs pétroliers de 1970 et 1980, la récession prolongée de 1990-1993, la crise financière de 2007-2010, la crise du Covid et la guerre en Ukraine de 2019 à 2022 sont les chocs économiques exceptionnels à l’origine d’environ la moitié de l’augmentation de la dette sur la période 2007-2023.
- La dynamique des taux d’intérêts et de la croissance : dans les années 1990, les politiques monétaires nécessitées par la préparation à l’euro ont maintenu les taux d’intérêts au-dessus du taux de croissance. La conséquence est que la dette sert à rembourser les intérêts de la dette précédente. Puis dans les années 2000, la baisse des taux d’intérêts a rendu l’endettement plus attractif.
- Depuis 1999 les baisses d’impôts ont réduit les recettes fiscales. Entre 2017 et 2024 la politique économique a creusé le déficit et alourdi la dette.
- Les gouvernements de droite comme de gauche ont contribué à une hausse de la dette. La période récente, depuis 2017, est marquée par une baisse importante de la fiscalité et donc une hausse notable de la dette (+ 1000 milliards).
- Le maintien de déficits budgétaires élevés rend nécessaire un débat sur la maîtrise des comptes publics. Il faudrait au moins stabiliser la dette. La Cour des comptes alerte sur la nécessité de réduire fortement ce déficit dès 2025.
Nous voyons donc que la dette publique résulte d’un cumul de crises économiques, de politiques économiques et monétaires, et surtout de baisses structurelles d’impôts. Sa maîtrise future dépendra de la capacité à réduire les déficits et à réformer la fiscalité.
Coût de la dette publique française
La France a dépensé 52 milliards d’euros en 2025 pour payer les intérêts de sa dette publique. Ce montant est comparable au budget de l’Éducation nationale. Il est inférieur à celui des États Unis, du Royaume Uni, de l’Italie. Il est supérieur à celui de l’Allemagne et du Japon. Il faut bien sûr rapporter ces comparaisons internationales à la taille des économies. La France se situe dans une position intermédiaire.
La charge de la dette française atteint sa moyenne historique, ce qui n’est pas dramatique mais la tendance est préoccupante. La combinaison de déficits élevés et de taux d’intérêts plus hauts alourdit le coût de la dette.
Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en 2024, l’instabilité politique affaiblit la capacité à mener une consolidation budgétaire.
La dégradation de la note de la dette française par les agences de notation pourrait inciter les créanciers à exiger des taux d’intérêts plus élevés.
Aujourd’hui la charge de la dette reste gérable mais la probabilité d’une crise n’est pas nulle, surtout en cas de persistance de l’instabilité politique et de hausse des taux.

Le poids des créanciers étrangers
La dette française est détenue pour plus de la moitié par des créanciers étrangers. Cette situation soulève des questions sur la dépendance financière et la soutenabilité de la dette. Les investisseurs étrangers sont plus sensibles aux risques et revendent plus facilement leurs créances. Les fonds spéculatifs, en particulier, amplifient la vulnérabilité aux chocs.
Néanmoins l’arrivée de non résidants fait baisser les taux en augmentant la demande de titres.
La détention étrangère de la dette n’est pas forcément une mauvaise nouvelle mais sa gestion doit être optimisée pour en limiter les risques et en tirer des avantages.
Un fardeau pour les générations futures ?

La dette est remboursée à court et moyen terme. Sa durée moyenne est de 8,6 ans. Ce sont donc les contribuables actuels qui en supporteront le poids et non les générations futures. Le vrai débat est qui paie la dette ?
Les créanciers renouvellent régulièrement leurs prêts à l’État comme ils le font depuis plus de deux siècles. La dette profite surtout aux plus fortunés qui bénéficient des baisses d’impôts, prêtent à l’État et perçoivent des intérêts. Tandis que les classes moyennes subissent les coupes budgétaires.
La dette est un outil de redistribution à l’envers. Elle devient un fardeau si les intérêts soutirés par les rentiers pèsent durablement sur le reste de la population.
La dette publique française n’est pas un problème de transmission aux générations futures mais de répartition sociale et de dépendance aux créanciers, nationaux et étrangers.
Réduire le déficit sans nuire à la croissance
La France doit réduire son déficit public après trois années de dérapage et une année d’instabilité institutionnelle. Une politique budgétaire trop restrictive peut être contre-productive. Il faut privilégier la hausse des recettes à la baisse des dépenses : l’impact économique d’une hausse progressive d’impôts touchant surtout les hauts revenus est moins négatifs que les coupes budgétaires. La taxation des grosses successions génère des recettes sans affecter la consommation des plus pauvres. Une trajectoire compatible avec la cohésion sociale et la transition écologique reste possible.

Une réduction intelligente du déficit doit allier hausse ciblée des impôts, étalement des efforts et protection de la croissance et des plus vulnérables.
Effacer l’ardoise est-ce possible ?

L’annulation de la part de la dette détenue par la Banque Centrale Européenne divise les économistes. Il est difficile dans le cadre de cet article de rentrer dans le détail technique de ce débat. L’annulation à elle seule ne peut suffire à assurer la soutenabilité de la dette mais une coordination européenne renforcée entre la Banque Centrale Européenne et les banques publiques nationales permettrait de réduire la dépendance aux marchés financiers et acteurs privés pour financer les investissements sociaux et écologiques non rentables financièrement.
La France est-elle au bord de la faillite

Dans le même magazine, Anton BRENDER, économiste co-auteur de « Économie de la dette » (La Découverte 2021), nous indique que la France n’est pas au bord de la faillite. Pour lui le problème est ailleurs. Il tient à notre incapacité collective à débattre de notre politique budgétaire en particulier. Le sujet est saturé de postures et de chiffons rouges. Les investisseurs ne s’inquiètent pas tant du niveau absolu de la dette que de l’incapacité du gouvernement à en maîtriser l’évolution. Ce qu’ils redoutent c’est l’incertitude politique.
La dette publique, selon cet économiste, n’est pas en soi un fardeau insupportable. Encore faut-il apprendre à arbitrer clairement entre ce que l’on finance par l’endettement et ce que l’on finance par l’impôt. C’est un enjeu de société que nous avons trop longtemps réduit à un simple enjeu comptable.
La baisse des impôts de production
Une étude sur la baisse des impôts de production (2021-2023) de l’institut des politiques publiques (IPP) a montré que la réduction de 10 milliards d’euros n’a eu aucun impact pour les entreprises concernées ni sur le chiffre d’affaires, ni sur l’investissement, ni sur la création d’emploi, ni sur les exportations. La réforme n’a pas généré d’effets macroéconomiques positifs.
Les inégalités s’envolent
Les dernières statistiques publiées par l’Institut national de la statistique publique (INSEE) montrent un accroissement record des écarts de richesse. Sont en cause, les effets de l’inflation et des politiques publiques anti-redistributives du gouvernement.
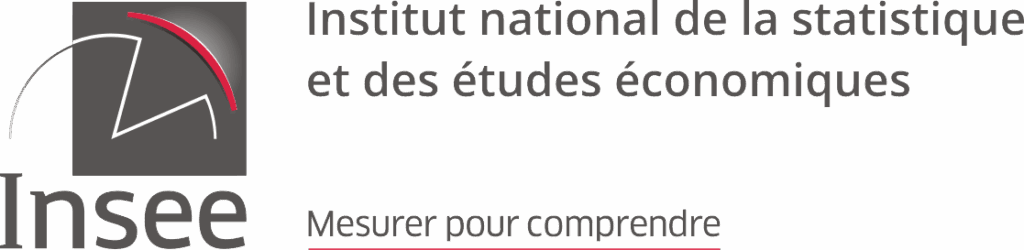
La pauvreté en 2023 n’a jamais été aussi importante en France depuis qu’on la mesure de cette façon, c’est-à-dire depuis 1996. Le taux de pauvreté a culminé cette année-là à 15,4% soit un pourcent de plus que 2022. Jamais la pauvreté n’a progressé aussi vite d’une année sur l’autre, y compris entre 2020 et 2021, en pleine crise sanitaire, ou entre 2008 et 2009, dans l’œil du cyclone de la crise financière. En 2023, 9,8 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté, à savoir 1 288 euros par mois pour une personne seule. C’est 650 000 personnes de plus qu’en 2022. Jamais le nombre de personnes pauvres n’avait été aussi élevé et jamais autant de personnes n’avaient basculé dans la pauvreté en un an.

A l’inverse les riches ne connaissent pas la crise. En 2023, les 20 % les plus modestes ont perçu 8,5 % de la somme des niveaux de vie et les 20 % les plus aisés 38,5 %, soit 4,5 fois plus. Si l’analyse porte sur l’évolution de ces indicateurs depuis 2017, le taux de pauvreté est passé en 6 ans de 13,7% de la population à 15,4% tandis que le niveau de vie plancher des 10% les plus riches s’est accru de 4,4%.
Plus de justice fiscale
Les ultrariches ont des taux d’imposition plus faibles que ceux du contribuable moyen. Ils paient en France environ 0,1% de leur patrimoine en impôt individuel sur le revenu. En tenant compte de tous les autres prélèvements obligatoires et exprimés en pourcentage du revenu, leurs taux d’imposition sont plus bas que ceux des classes moyennes ou des cadres supérieurs.
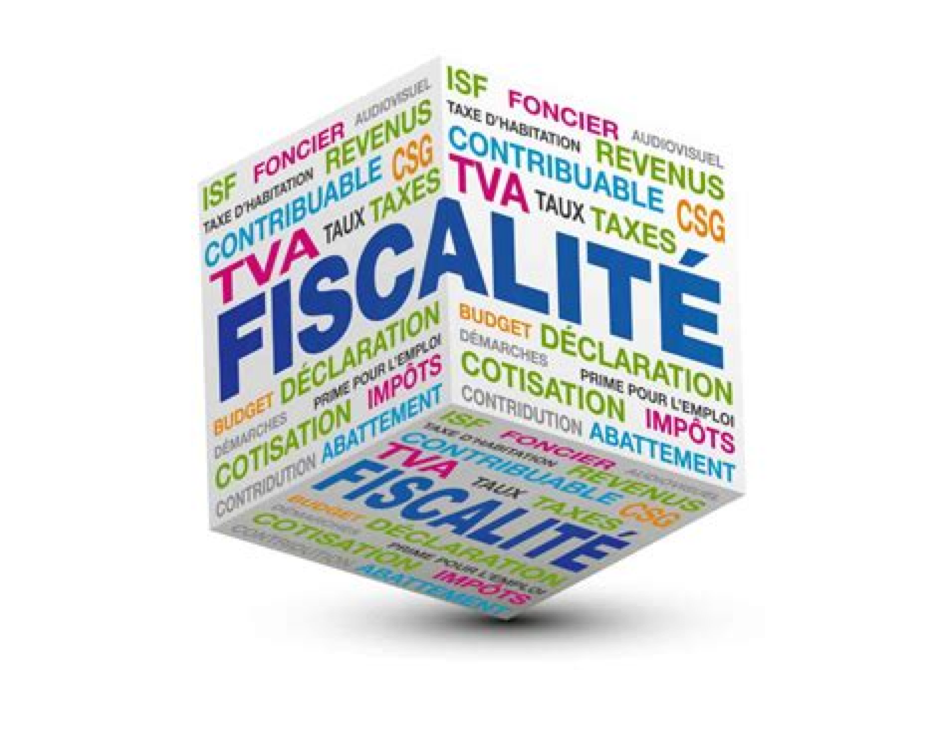
Les grandes fortunes peuvent structurer leur patrimoine afin d’échapper à l’impôt sur le revenu notamment par la création de holdings familiales dans lesquelles les dividendes s’accumulent à l’abri du fisc. Cette situation est le produit de décisions humaines et de choix politiques.
Pour quelle politique économique
La situation budgétaire est le résultat de la politique économique menée depuis plusieurs années. Cette politique est le fruit de choix idéologiques, présentée comme la seule possible pour faire face à la situation du pays.
Dans la deuxième partie du XXème siècle les prophètes du néo-libéralisme de « l’école de Chicago » sont convaincus que du déchainement des appétits privés jaillira un bien-être collectif. Ils promettent l’opulence par le libre jeu du marché, le plein emploi par la croissance, la productivité par la compétition, la prospérité commune par la rentabilité, la mise en valeur de toute la planète par la libre circulation des capitaux et la richesse monétaire comme valeur suprême.

Depuis que cette vision néolibérale s’est imposée dans les années 1980, le taux de croissance des revenus du capital s’est accéléré alors que la croissance des revenus du travail a stagné voire reculé. Sans un rééquilibrage de ces taux de croissance du capital et du travail et sans une politique volontariste de redistribution par la fiscalité et les prestations sociales, les inégalités ne pourront que continuer à se développer.
L’objectif premier de toute société démocratique est d’améliorer le sort de tous. Le bien-être de tous au niveau national comme au niveau international doit être le guide de toute action individuelle et collective.

L’inégalité est à la fois la cause et la conséquence de la faillite du système politique. Si, comme dit Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, l’État continue à laisser le 1% de la population s’accaparer l’essentiel des richesses et met à contribution les classes moyennes et populaires, il laisse se développer une désespérance qui ne peut que nuire à la démocratie.
Il n’est pas possible de continuer à imposer un discours incontestable dans ses présupposés comme dans ses conséquences, imposant ses décisions dans tous les domaines de la vie économique et sociale, et dans le même temps prétendre agir dans l’intérêt général et pour le bien être du plus grand nombre. Cette lecture idéologique présentée comme une « vérité » ne pourra que conduire la France à reproduire les mêmes erreurs qui se traduiront par une austérité qui sera non seulement injuste socialement, mais aussi contre-productive économiquement avec le risque de ne pas parvenir à réduire le déficit public autant qu’escompté.