Au-delà du chaos politique qui se déroule à l’assemblée nationale sans majorité politique claire, conséquence de la dissolution de l’assemblée nationale par le Président de la République le 9 juin 2024, le gouvernement français semble condamné à faire du sur-place. Les élections européennes ont donné des ailes aux différents groupements politiques d’extrême droite ou i-libéraux.

La situation internationale avec la victoire de Donald Trump aux élections états-uniennes est suspendue aux décisions erratiques du nouveau président de la première puissance mondiale. L’invasion de l’Ukraine par la Russie du président Poutine et la guerre au Proche-Orient ne diminuent pas l’incertitude du lendemain. Le monde mis en place au lendemain de la deuxième guerre mondiale, basé sur le droit international et le respect des frontières est progressivement remplacé par un monde basé sur les rapports de force.

Le déclin industriel
L’activité économique mondiale est considérablement ralentie. La mondialisation des rapports économiques est en pleine mutation. L’Europe n’échappe pas à ce phénomène et notamment la France.

Les fragilités de l’industrie française ne sont pas nouvelles et le contexte général dans une économie ouverte n’améliore pas les choses. Les annonces de fermetures d’entreprises et de suppressions de postes se multiplient. Le chômage remonte, les compétences et le savoir-faire se perdent. Les sous-traitants et les services de proximité subissent les conséquences. Même si la France est particulièrement touchée, le déclin industriel touche plusieurs pays européens. Les pays développés ont massivement externalisé leur production vers les pays où les salaires étaient faibles, les normes environnementales peu contraignantes et la fiscalité avantageuse. Les prix ont été poussés à la baisse pour les consommateurs. Les producteurs qui ne suivaient pas le mouvement étaient vite dépassés. Cette logique implacable est encore à l’œuvre aujourd’hui. Même l’industrie allemande, bien plus solide que la nôtre, vacille sous les assauts de la concurrence mondiale.

Les milliards d’euros d’argent public investis pour sauver le tissu industriel pendant la pandémie de la Covid-19 et la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine, les plans de sauvetage européens décidés cet hiver, les concessions aux exigences des industriels qui sapent les normes environnementales, sociales et fiscales, ne permettent pas d’obtenir des résultats satisfaisants. Les réponses habituelles tournent autour de la compétitivité et l’emploi. Elles n’intègrent pas le nouveau contexte international où les rivalités géostratégiques, les objectifs de compétitivité et de sécurité prennent le pas sur la transition écologique et la cohésion de nos sociétés.
Le débat sur les finalités de la politique industrielle concerne toute la société et pas seulement les industriels. Si, comme l’a dit le PDG de LVMH, la gestion d’une entreprise est l’affaire de son dirigeant, le cadre dans lequel s’exerce cette entreprise est l’affaire de la collectivité dans le respect de l’intérêt général et du bien commun
Le décrochage
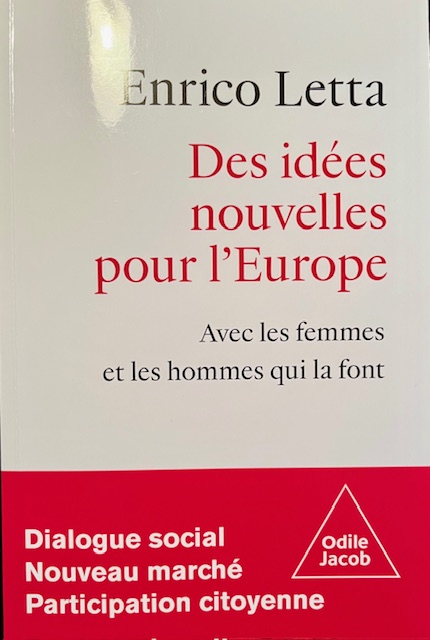
Enrico Letta, ancien président du conseil des ministres d’Italie et actuellement président de l’institut Jacques-Delors, dans un rapport présenté à l’Union Européenne, estime que l’économie européenne est en décrochage et que l’on ne peut plus attendre. Les puissantes forces de changement, qui couvrent la démographie, la technologie, l’économie et les relations internationales, exigent des réponses politiques innovantes et efficaces. Il propose des recommandations pour l’avenir qui devraient être mises en œuvre à la fois au niveau des institutions européennes, des États membres, des partenaires sociaux et des citoyens.

Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, dans un rapport qui a aussi eu de larges échos, a esquissé une stratégie sur la base d’une analyse du positionnement international des entreprises européennes. L’économie européenne est condamnée à « une lente agonie » si elle ne change pas. Il plaide pour une politique européenne commune alors que les politiques industrielles restent nationales et peu coordonnées. La consolidation de l’appareil industriel européen et le développement de nouvelles filières rendent indispensable une coordination à l’échelle européenne. La rivalité pour les emplois et les subventions publiques risquent de générer des surcapacités et de conduire à des pertes financières et environnementales.

Ces deux rapports, même si nous pouvons en discuter certains aspects, vont dans le bon sens et ont l’immense mérite de tordre le coup au dogme de l’austérité budgétaire. Ils s’accordent sur le fait que l’Europe doit investir massivement si l’on ne veut pas devenir dépendants des États Unis et de la Chine. Reste à discuter des différentes visions sur le modèle de développement et des indicateurs de bien-être que l’on souhaite mettre en avant. Comme le propose par exemple Thomas Piketty « l’Europe doit au contraire saisir l’occasion pour développer d’autres modes de gouvernance et éviter de donner, une fois de plus, les pleins pouvoirs aux grands groupes capitalistes privés pour gérer nos données, nos sources d’énergie ou nos réseaux de transport. » Cela fait partie du débat démocratique.

Le déni du personnel politique et des économistes
Incapables de sortir des habitudes du passé une part de plus en plus importante du personnel politique semble s’éloigner des dangers que représentent la crise climatique et l’effondrement de la biodiversité. La transition écologique est repoussée à plus tard. Sont à l’ordre du jour les excès de normes, l’écologie punitive, les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, la ré-autorisation d’insecticides dangereux, la croyance aveugle que les progrès technologiques nous permettront de surmonter les difficultés…

Les climatologues et biologistes ont beau avoir alerté la planète, pendant des décennies, qu’une catastrophe est en cours, et avoir répété qu’elle est forcément dévastatrice pour l’activité humaine, la science économique a continué à caresser ses modèles de croissance comme si de rien n’était. Les économistes hétérodoxes qui remettent en cause le système capitaliste, sont persona non grata dans la plupart des facultés d’économie, sans parler des grandes revues scientifiques. Le grand paradoxe, c’est qu’à l’origine la nature était au cœur de l’analyse économique. Au XVIIIe siècle, les premiers économistes étaient appelés les « physiocrates » pour qui toute richesse venait de la terre. Il est grand temps aujourd’hui pour la science économique d’opérer un retour aux sources, de proposer une compréhension synthétique et cohérente des différents enjeux écologiques dans la pensée économique et de travailler de façon pluridisciplinaire.
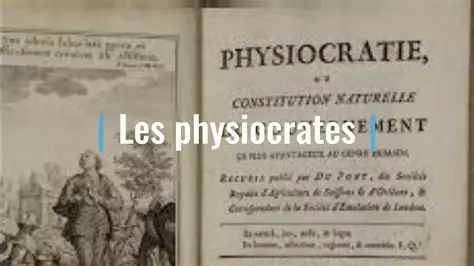
La réindustrialisation
Avec l’augmentation des tensions géopolitiques le fait de produire sur son sol les biens essentiels est un gage d’autonomie et protège les acquis économiques et sociaux. Dans un monde aussi interdépendant, la réindustrialisation présente des synergies et des contradictions. Produire plus ? Quoi et comment ? Assouplir les normes ? réduire les délais liés aux expertises environnementales ?

Une politique industrielle dirigée vers la transition écologique peut permettre de produire sur le sol français ou européen les biens indispensables avec des standards plus élevés. La réindustrialisation respectueuse des limites physiques de la planète suppose une planification démocratique des besoins, des arbitrages, et une politique industrielle mise au service d’un projet de société écologique.
L’industrie peut être un levier stratégique puissant si elle est pensée à la hauteur des défis du XXIème siècle. Pour cela il faut un cap clair orienté vers la transition écologique et la sobriété, des mécanismes de financement et de commandes publiques à la hauteur, une gouvernance démocratique qui associe les territoires et les parties prenantes et une Europe capable d’articuler concurrence et coopération entre États membres. Plutôt que de répliquer les logiques du passé, il s’agit de faire de la réindustrialisation un vecteur de transformation de nos systèmes productifs.

Penser que nous resterons compétitifs en demeurant totalement ouverts est une illusion. Par exemple dans le domaine des technologies de décarbonation, les producteurs chinois pratiquent des prix de dumping du fait d’une surproduction. Comment les entreprises françaises pourraient émerger et rester concurrentielles sans changer notre approche ? Sans la mise en place d’une politique anti-dumping nous peinerons à faire apparaître de nouvelles activités en Europe.

L’État subventionne les entreprises afin de soutenir l’activité, l’innovation et l’emploi. Ces aides sont insuffisantes pour orienter vers une économie durable et plus inclusive. La plupart des allègements fiscaux et sociaux sont accordés automatiquement et ne permettent pas de s’assurer que les incitations produisent les effets escomptés. Les subventions doivent permettre un meilleur ciblage des projets et être directement liées aux objectifs définis par la puissance publique. Les entreprises doivent contribuer activement aux objectifs collectifs de croissance durable et inclusive.
L’économie n’est pas une science neutre
Pour conclure nous voyons bien que l’économie n’est pas une science exacte ni une science neutre. Elle fait partie des sciences humaines. Elle nous aide à comprendre et agir sur le monde pour le progrès de l’humanité. L’histoire de la science économique est un balancement entre connaissance et action.
Les indicateurs que nous choisissons de privilégier, production, emploi, satisfaction des besoins sociaux, soutenabilité écologique, sont toujours porteurs d’une vision du monde et d’un projet de société. Il n’est pas possible pour les économistes orthodoxes de continuer à imposer un discours de nature transcendante, incontestable dans ses présupposés comme dans ses conséquences, imposant ses décisions dans presque tous les domaines de la vie sociale. Et dans le même temps, prétendre agir en fonction de principes fondamentalement humanistes sur le plan individuel et démocratiques sur le plan collectif.

La réaffirmation de l’humanisme passe donc inévitablement par une réflexion critique sur la question économique. Depuis plus d’un siècle, on veut enfermer l’homme dans des schémas économiques théoriques, transformant l’humain en capital, voire en matériel. Retrouver tout le sens de l’humain est un enjeu majeur pour dépasser un siècle d’aliénation.
Pour René PASSET, professeur émérite d’économie à l’université de Paris, quand l’économie se trouve confrontée aux questions du « trop » et des inégalités de répartition, la question des finalités fait surface. Lorsque le « plus » cesse de constituer le critère du « mieux », on voit surgir la question du « pourquoi », c’est-à-dire des finalités.
Références bibliographiques :
- Revue HUMANISME n° 291 Février 2011 – dossier « L’économie contre l’humanisme »
- René PASSET – « les grandes représentations du monde et de l’économie à travers l’histoire » – éditions les liens qui libèrent – 2010
- « Comprendre et agir sur le monde pour le progrès de l’humanité » Maurice Abitbol – blog citoyen- changer de monde -2020
- « Des idées nouvelles pour l’Europe », Enrico Letta – Odile Jacob – 2024
- « Les nouvelles règles du jeu », Georges Papaconstantinou et Jean Pisani-Ferry – Seuil – 2024
- « Le monde confisqué » Arnaud Orain – Flamarion – 2025
- « Le capitalisme de l’apocalypse » Quinn Slobodian – Seuil – 2025
- La revue trimestrielle « L’Économie politique », co-édité par « Alternatives Économiques » et « l’Institut Veblen pour les réformes économiques », numéro 106 de mai 2025 « Réindustrialiser pour quoi faire ? ».
- Divers articles sur la réindustrialisation en France et en Europe du journal « Le Monde », de la Revue « Le Grand continent » et de la revue « Alternatives économiques ».